|
PRÉFACE de L'éditeur AUDIN
à Paris en 1834 - Traducteur Jules Lapierre Le Robinson Suisse, Der Schweizer Robinson, est un livre populaire en Allemagne.' Presque toutes les littératures européennes s'en sont emparées. Il été traduit en anglais, en italien, en espagnol, en russe. Ce fut Madame de Montolieu qui, la première, fit connaître en France le journal d'un pasteur naufragé. Pendant tout le temps qu'elle vécut, le nom de l'écrivain original, M. Wyss, fut conservé sur le titre de la traduction. A sa mort, il en a été effacé ; et le Robinson Suisse semble être ainsi attribué à l'auteur de Caroline de Lichtfeld. L’éditeur |
|||
 |
|||
 |
|||
| PRÉAMBULE de Madame Elise Voïart Une famille suisse, que des espérances de fortune appelaient en Amérique, s'était embarquée au Havre sur un bâtiment marchand destiné à transporter des colons dans le nouveau monde. Un parent éloigné de M. Starck (c'est le nom du chef de cette famille) venait d'y mourir, en léguant toutes ses propriétés à son cousin, à condition que celui-ci viendrait s'y établir avec tous ses enfants. Six personnes, le père, la mère et quatre garçons d'âges et de caractères différents, composaient cette famille; L'aîné, qu'on appelait Frédéric, avait quinze ans: c'était un grand et beau garçon plein de force et d'agilité, tête vive, bon coeur, plus habile dans les exercices du corps que dans ceux de l'esprit; il n'était point dépourvu d'intelligence, mais il en avait moins que son frère Ernest. Celui-ci, âgé de treize ans, était d'un caractère lent et même un peu paresseux; mais, naturellement attentif, observateur et réfléchi, Ernest cherchait sans cesse à s'instruire. Il avait surtout un grand goût pour l'histoire naturelle, et il possédait déjà une quantité de connaissances, fruit de ses expériences et de ses observations. Le troisième garçon, dont le nom était RudIy, diminutif de celui de Rodolphe avait douze ans. C'était un franc étourdi, un peu présomptueux, hardi et entreprenant, mais au demeurant un excellent enfant, et rachetant par les qualités de son coeur la légèreté de son esprit. Enfin le plus jeune de tous, que sa mère et ses frères appelaient volontiers le petit Fritz, n'était encore qu'un petit garçon de huit ans, bien gai, bien doux, et dont l'enfance un peu maladive avait retardé l'instruction. Il ne savait rien encore; mais, comme il était attentif et docile, il ne devait pas tarder à acquérir l'instruction en rapport avec son âge et ses facultés. M. Starck était un homme dans la force de l'âge, chrétien sincère, dévoué à ses devoirs de père et de citoyen. L'excellente éducation qu'il avait reçue, jointe à beaucoup de lectures, l'avait mis en état d'élever lui-même ses enfants et de leur faire contracter de bonne heure ces habitudes d'ordre et de travail auxquelles il avait dû lui-même le bien-être dont il avait joui jusqu'alors. Il voulait que la pratique accompagnât la théorie, et surtout que ses fils apprissent, autant que possible, à se suffire à eux-mêmes en une foule de choses pour lesquelles souvent la plupart des enfants réclament l’aide ou les soins d'un domestique. Tout jeunes, ses enfants savaient manier assez adroitement la scie et le marteau, et il ne se posait pas une planche ou un clou dans la maison que ce ne fût de la main plus ou moins habile des petits garçons. De plus, élevés à la campagne, ces enfants, presque tous d'une constitution robuste, étaient accoutumés à supporter, sans danger pour leur santé, le froid, le chaud, la pluie et toutes les intempéries des saisons. Habitués à visiter les étables et les écuries de la ferme de leur père, ils n'avaient peur ni des boeufs ni des chevaux, ni d'aucune autre espèce d'animaux domestiques. Dans l'occasion, ils auraient même su les traire et les conduire, Le père, en dressant ainsi ses fils au travail et à la fatigue, n'avait eu en vue que de fortifier leur tempérament, de les aguerrir contre mille petites craintes puériles dont les enfants sont souvent saisis à l'aspect des animaux, mais surtout de leur donner cette expérience pratique des choses de la vie que l'étude des livres ne donne point, et qui, en apprenant aux enfants à tirer d'eux-mêmes leurs propres ressources, en fait par la suite des hommes utiles aux autres et pleins d’une véritable indépendance pour eux-mêmes. Il ne savait pas, ce bon père, qu'en agissant ainsi il préparait à ses fils les moyens non seulement de se tirer des plus terribles dangers, mais encore d'assurer leur sort et celui de toute la famille. La digne épouse de M. Starck, qu'il appelait souvent ma bonne Élisabeth, était le véritable type de la mère de famille. Uniquement occupée des soins de sa maison, elle la régissait avec et gaieté. L'amour qu'eIle portait à ses enfants était aussi éclairé que tendre; le sentiment religieux dont son âme était pénétrée, la préservait de toute faiblesse pour leurs petits défauts, et il était rare que ses douces remontrances demeurassent sans effet sur des enfants qui lui portaient autant de respect que d'attachement. Appelé, comme nous l'avons dit, à recueillir un riche héritage dans le nouveau monde, M. Starck, dans l'espoir d'assurer à sa famille un avenir plus avantageux, n'hésita point à quitter sa patrie et à s’embarquer avec tous les siens pour Philadelphie. Le commencement du voyage fut des plus heureux. Suivant sa coutume, le père ne manqua pas de profiter des nouvelles circonstances où il se trouvait pour ajouter aux connaissances pratiques de ses enfants. L'ordre et l'admirable arrangement qui règnent sur un bâtiment, le travail intelligent et régulier de l'équipage, l'examen de la boussole, la puissance de la barre du gouvernail, tous ces grands effets de l'art nautique où les puissances du calcul et de l'équilibre exécutent tant de merveilles, tout fut, pendant cette traversée, une source journalière et intarissable d'étonnement et d'instruction pour les fils de M. Starck. Ils apprenaient des matelots à faire et défaire ces nœuds marins si simples et si indissolubles ; s'exerçaient à rouler des câbles, à faire mouvoir le cabestan, et quand le charpentier avait quelques réparations à faire, il était toujours assisté par nos petits garçons: Frédéric tournait avec ardeur l'énorme tarrière, Rudly enfonçait les chevilles de bois fi grands coups de mailllet , et Ernest ne paraissait pas prendre une part aussi active que les autres au travail, il n'en était pas moins occupé à faire une foule d'observations curieuses ou utiles sur la manière dont l'ouvrier s'y prenait, soit pou retourner presque seul d'énormes pièces de bois, soit pour les dresser à l'aide du levier; enfin, rien n'échappait à l'enfant, qui enrichissait ainsi son esprit et sa mémoire d'une foule de notions qui devaient bientôt lui devenir nécessaires. On était déjà parvenu au 40" degré de latitude, et tout faisait espérer qu'avant dix jours la navigation aurait son terme, quand tout à coup les vents, jusqu'alors favorables, changèrent, et soufflèrent avec une telle violence, que, malgré toute l'habileté de l'équipage, le bâtiment fut jeté hors de sa route et poussé dans des mers inconnues; une tempête effroyable éclata, et, durant dix jours et dix nuits, sa fureur ne fit que s'accroître: dans ces terribles circonstances, M.Starck et son fils aîné, le seul qui pût prendre une part active au travail de la pompe, firent preuve du plus grand dévouement. Mais enfin, vaincus par la fatigue, ils vinrent se jeter sur un matelas dans la chambre de poupe, où la mère, entourée de ses plus jeunes enfants, était en prière et recommandait à Dieu tous les objets de sa tendresse. Pendant qu'ils prenaient ainsi un peu de repos, un grand bruit se fit entendre sur le pont... Mais nous laisserons M. Starck lui-même continuer la relation de cet événement, ainsi que celle de tout ce qui le suivit. Puisse cette narration offrir une lecture agréable à nos jeunes lecteurs, et leur démontrer cette importante vérité, que, quelle que soit la grandeur des infortunes auxquelles Dieu nous soumet quelquefois, la Providence n'abandonne jamais les hommes qui ne s'abandonnent point eux-mêmes! Le traducteur Madame Elise Voïart. |
|||
| INTRODUCTION à l’Edition de 1841 du Robinson Suisse par Lavigne - Paris
Daniel de Foë eut un jour une grande pensée: il lui vint l'idée de mettre un homme aux prises avec tout ce qu'il y a de plus redoutable pour l'homme: la nécessité, le péril, et surtout la solitude, Il voulut que cet homme n'eût dans son état désespérant de misère et d'abandon, que deux auxiliaires: le courage moral qui ne se rebute de rien, et cette providence proverbiale des malheureux, qui aide toujours ceux qui s'aident. Il montra ce que peuvent l'instinct naturel de la conservation, la patience d'un caractère énergique et résolu, la résignation enfin, qui est la patience élevée au rang des vertus chrétiennes, |
||||||||||||
 |
||||||||||||
|
Les besoins les plus intimes du coeur ont été mis en oubli dans cette composition; vous n'y entendrez nulle part ni la voix consolante des femmes, ni les bégayements délicieux des petits enfants; vous n'y aimez rien, pas même Robinson: la sympathie qui vous entraîne vers lui dans tout le cours de sa lutte héroïque avec la destinée n'est pas le résultat d'un sentiment affectueux; c’est tout simplement le retour involontaire de votre pensée sur vous-même; c'est cet instinct universel, ou d'égoïsme, ou de pitié, qui vous associe par l'imagination à des malheurs que vous auriez pu subir. |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
| M. Wyss n'a pas voulu s'arroger le mérite de l'invention ; il l’a acceptée, il l'a subie, il ne s'est donné que pour l'imitateur et le copiste d'un grand modèle; mais imiter comme M.Wyss, c’est mieux qu'inventer: c'est appliquer une invention reçue au plus important de tous les objets d'utilité possible; c’est prêter une âme à l'ébauche de l'artiste; c'est faire marcher la statue de Pygmalion. Le Robinson anglais restera un beau et bon livre, le Robinson Suisse mérite peut-être la première place parmi les ouvrages d'imagination destinés à l'enseignement des enfants et à celui des hommes. Ne cherchez ni dans les roman, ni dans les écrits les plus spéciaux eux-mêmes qu'ait inspirés une douce philanthropie éclairée par la science, un code d'éducation physique, intellectuelle, morale, à préférer à celui-ci. Je voudrais qu'il pût se trouver, mais vous ne le trouveriez pas. Ces bonnes fortunes du coeur et du génie, auxquelles la munificence de M. de Monthyon a réservé un riche prix annuel, ne sont pas tout à fait si commues qu'il paraît l'avoir pensé: il s'en présente au plus trois ou quatre par siècle, et toutes ne sont pas de même valeur. Le spectaele de la Nature, de Pluche; le Comte de Valmont, de l'abbé Gérard; l'Ami de la Jeunesse, de Filassier; le Magasin des Enfants, de madame Leprince de Beaumont; quelques autres encore, et bien peu, « apparent rari nantes! »composeraient cette bibliothèque d'élite qui s'augmente trop lentement. En attendant qu'il en arrive, si j'avais l'honneur d'exercer quelque influence sur les délibérations de l'Académie française, je l'engagerais à donner le prix tous les ans au Robinson Suisse de M.Wyss, et à faire distribuer gratuitement cet ouvrage dans les écoles. Je conviens que cette disposition ne serait peut-être pas fort conforme au texte rigoureux du testament; mais je suis convaincu qu'elle remplirait exactement les intentions du donateur. Le Robinson Suisse de M. Wyss, c'est Robinson en famille. A la place de ce marin téméraire et obstiné qui se débat contre la mort dans une fatigante agonie, c'est un père, c'est une mère, ce sont de charmants enfants, divers d'âge, de caractère et d'esprit, qui vont fixer votre intérêt; et ne vous imaginez pas que l'intérêt se soit réduit en se divisant. Il se multiplie, au contraire, par toutes les sympathies que cette famille inspire. La combinaison du nouvel auteur a changé toute l'économie de sa fable; elle vous a transporté du dernier séjour d'un aventurier au berceau de la société humaine. Elle va vous faire voir comment se forment les peuples éclairés par la sagesse de Dieu et secourus par les miracles de sa providence. L'ile de Robinson s'élargira sous vos yeux; vous pourrez y étudier jusqu'aux progrès d'une civilisation rapide qui embrasse toutes les périodes de l'histoire du monde. Le Robinson Suisse est un de ces hommes qui ont beaucoup appris dans l’unique et louable dessein de savoir, et que la nécessité, cette régente impérieuse des esprits, force tout à coup à transformer leurs théories en pratique. Il a sur l'homme naturel et inculte l'avantage de l'instruction; il connaît les choses, comme Adam, par leurs noms et par leurs propriétés, avantage merveilleux que notre espèce devait à sa propre nature, qu’elle a perdu dans sa déchéance, et qu'elle ne ressaisit lentement qu’en recueillant une à une toutes les découvertes et toutes les notions de générations passées; mais ce précieux travail d'une intelligence élevée, il l'avait fait. Tout ce qu'on peut savoir, il le sait, tout ce que la création a de mystères pénétrables et utiles, elle le lui révèle; et, comme cette science qui vient de Dieu, s’est élaborée dans un esprit judicieux et soumis, elle a contribué à le confirmer dans sa foi. C'est cet homme qui a une femme et des enfants à abriter, à nourrir, à vêtir, à loger, à meubler d'une manière conforme à leurs habitudes, avec les simples ressources du désert ; c'est cet homme qui y parvient à force de rudes travaux, d’infatigables efforts et de confiance dans la bonté sans borne du Maître de toutes choses. Son histoire contient donc toute l’histoire de l'homme et de la société elle-même, l'espace renfermé dans un lieu étroit, le temps dans une courte succession d'années, l’oeuvre si longue et si patiente de l'humanité dans l'économie intérieure d'un petit ménage. C'est le sommaire le plus attachant, le plus agréable à lire, d'une Encyclopédie conçue par de véritables sages, et appropriée à nos véritables besoins. Il suffit d'y réfléchir un moment pour concevoir que le plan de M. Wyss embrasse un cours d'éducation tout entier, et qu’il conduit l'auteur, à travers une seule génération, aux Iimites raisonnables du progrès, en prenant ce dernier mot dans sa juste valeur, c'est-à-dire sans égard aux prétentions extravagantes de ces sophistes impies qui construisent toujours Babel. Le Robinson Suisse demande à la nature tous les secours qu'elle peut offrir à l’homme et la nature ne lui en refuse aucun, car toute la création est faite pour l’homme. Rien ne manque à la patience laborieuse, rien ne manque à l'industrie inventive, que les choses dont la nécessité ne s’est pas fait sentir encore, et peut-on dire qu'une chose manque lorsqu'elle n'est pas nécessaire? L'île du Robinson Suisse est, à la vérité, très favorisée dans ses productions; mais c'est à défaut de recherches, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, à défaut de besoins que nous ne trouvons pas les mêmes ressources partout où nous portons nos pas et nos regards. Quel citadin n'a foulé dédaigneusement l'ortie et la fougère, les plantes les plus méprisées, sans se douter qu'il y avait là un aliment agréable et salubre, un tissu qui ne le cède pas à celui du chanvre, un papier bien préférable à celui que nous tirons maintenant du coton, un pain savoureux, un cristal brillant et limpide? Nous sommes bien insouciants et bien ingrats ! Le Robinson Suisse met à profit tous ces bienfaits de Dieu pour en rapporter la gloire à Dieu; il étudie, il apprend avec ses élèves, et c'est la bonne manière d'enseigner; chaque découverte amène un essai, chaque essai engendre un art ou un métier: toutes les journées portent leurs fruits; toutes Ies découvertes, tous les succès, se récapitulent en actions de grâces pour le Créateur. Comme cette vie est animée de bonnes études, de travaux utiles et fortifiants, de pieuses élévations vers le Seigneur, de douces et tendres émulations à qui contribuera le mieux au bien-être de tous l Qu'on me fasse voir quelque part un système d'instruction primaire qui vaille celui-là, et mes éloges lui sont assurés d'avance, vint-il de Locke, de Rousseau, des philosophes et de l'Université. Il me reste peu de choses à dire, car je n'ai pas le droit de louer l’excellente traduction de madame Voïart, dont la réputation était faite quand l'éditeur l'a adoptée. Il ne m'est guère plus permis d’insister sur le mérite d'exécution matérielle de cet admirable Iivre. Comme l'histoire naturelle y occupe une grande place, il avait plus de droits qu'aucun autre à s'enrichir de ces illustrations dont le luxe typographique a introduit la mode. Elles y étaient, pour ainsi dire, indispensables, et les naturalistes conviennent, comme les amateurs des arts, qu'elles ne laissent rien à désirer. Quant à mon enthousiasme pour l'ouvrage de Wyss, qu'il fallait peut-être justifier par des développements plus étendus, c'est un soin dont je peux me dispenser, maintenant que le livre est ouvert. Le lecteur jugera. CHARLES NODIER, De l’Académie Française. |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||








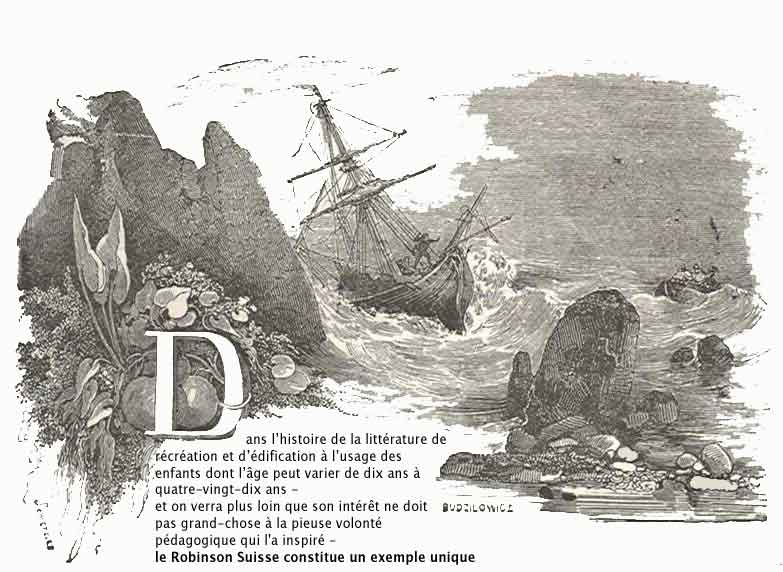



 C'est un jardin botanique où se multiplient les espèces les plus variées. Il ne faudrait pas moins des cinq continents réunis pour peupler ce
C'est un jardin botanique où se multiplient les espèces les plus variées. Il ne faudrait pas moins des cinq continents réunis pour peupler ce